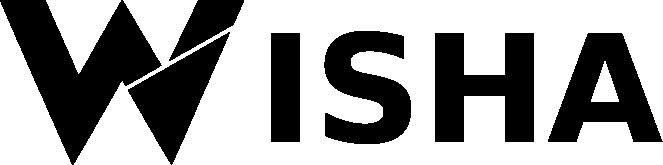Baise-en-ville de Martin Jauvat

Vous pensez que la comédie populaire française est morte ? Pas tout à fait. Disons plutôt qu’elle survit sous assistance respiratoire. Les entrées tiennent encore à peu près, mais la qualité, elle, s’érode d’année en année. L’humour, déjà rarement brillant, s’enfonce dans une redondance fatigante, au point de donner l’impression de voir le même film quinze fois par an, avec une affiche différente et deux ou trois vannes recyclées.
Et puis, parfois, surgit une anomalie. Un film qui détonne. Un vent de fraîcheur inattendu dans ce paysage un peu sinistré. Cette anomalie s’appelle Martin Jauvat. Après Grand Paris, comédie fauchée mais débordante d’idées sur cette « banlieue invisible » que le cinéma regarde rarement, le cinéaste revient avec Baise-en-ville, bien décidé à inscrire Chelles, sa ville natale, sur la carte du cinéma français.
Quand on pense film de banlieue, les images qui viennent immédiatement à l’esprit sont celles de La Haine, Les Misérables ou Athena. Martin Jauvat prend volontairement le contre-pied de cet héritage. Sa banlieue est pavillonnaire, aisée, presque trop propre, et assume une inspiration très américaine. Une banlieue qui évoque directement The Truman Show — film que le réalisateur avait présenté à la Cinémathèque idéale des banlieues du monde en 2022. Ville artificielle, décor presque fantomatique, habitants qui semblent toujours apparaître aux mêmes endroits, à la même heure : tout concourt à créer un univers volontairement factice, renforcé par une image aux accents seventies dans un récit pourtant contemporain.
Et c’est là que Baise-en-ville marque déjà un point décisif. Cette ambiance, entièrement assumée, est son premier grand atout. Le film impose son monde avec une telle cohérence qu’on finit par s’y laisser happer. Même si les premières minutes peuvent susciter un certain scepticisme, plus le récit avance, plus l’envie de suivre Jauvat dans son univers grandit.
Cette atmosphère singulière s’accorde parfaitement à la mise en scène. Martin Jauvat joue volontairement avec des effets kitsch que le cinéma français semble avoir bannis depuis des années, et les détourne pour nourrir le potentiel comique du film. Un choix audacieux, souvent payant, même s’il constitue aussi la principale limite du long métrage. Là où Grand Paris brillait par une impertinence constante, Baise-en-ville se fait parfois plus consensuel. L’humour reste frais, mais moins surprenant, moins mordant. Un compromis compréhensible si l’on vise un public plus large, mais qui empêche le film d’atteindre la saveur irrésistible de son prédécesseur.
Le point de départ du récit donne immédiatement le ton : toute l’intrigue repose sur une bonde de baignoire, confisquée par la mère de Sprite pour l’obliger à sortir de sa torpeur. Un déclencheur absurde, mais redoutablement efficace, qui enferme le personnage dans un cercle bien connu : pour travailler, il lui faut le permis ; pour passer le permis, il lui faut travailler. Une mécanique simple, presque bête, mais qui résume avec une justesse désarmante l’impasse sociale du personnage.
Martin Jauvat ne se contente pas de réaliser le film, il en incarne aussi le rôle principal, et démontre une vraie force comique. Il s’entoure d’une galerie de seconds rôles parfaitement exploités : William Lebghil et Emmanuelle Bercot sont impeccables, mais c’est surtout Sébastien Chassagne qui forme avec Jauvat un duo absolument hilarant. On croise également Michel Hazanavicius, passé de l’autre côté de la caméra, et qui prouve que son sens de la comédie ne se limite pas à l’écriture ou à la mise en scène.
Baise-en-ville est un film sincèrement enthousiasmant qui, malgré quelques limites, impose clairement Martin Jauvat comme l’un des réalisateurs de comédie les plus intéressants à suivre aujourd’hui. Dans un paysage français souvent frileux et formaté, le film accomplit l’essentiel et le fait avec une vraie personnalité : faire rire, surprendre, et donner la sensation rare d’avoir vu quelque chose de différent. Pas un film parfait, mais une anomalie précieuse.