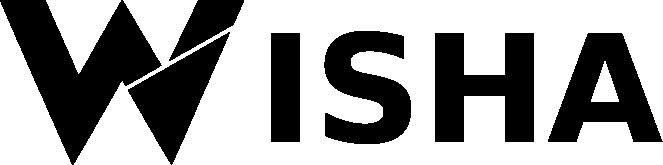À pied d’œuvre : créer, coûte que coûte

Toute personne travaillant dans un milieu artistique connaît ce moment charnière où son travail ne suffit plus à payer les factures. Le dilemme est alors brutal, accepter un emploi « alimentaire » qui grignote le temps et l’énergie nécessaires à la création, ou s’enfoncer dans une précarité assumée, mais risquée. Pour celles et ceux, dont j’ai fait partie, qui ont traversé cette situation, le nouveau film de Valérie Donzelli, À pied d’œuvre, résonne avec une justesse particulière.
Le film suit Paul Marquet, ancien photographe reconverti à l’écriture. Auteur de trois livres, il n’arrive pas à écrire le quatrième, celui qui doit être son « grand livre ». À court d’argent mais convaincu qu’il lui faut du temps pour créer, il se tourne vers le jobbing, une succession de petits boulots mal payés, mais suffisamment souples pour lui laisser l’espace mental nécessaire à l’écriture. Si Donzelli capte ici un phénomène de société bien réel, elle choisit avant tout de raconter l’histoire d’un homme, d’un individu singulier.
Une maîtrise technique nouvelle
Valérie Donzelli affirme ne pas être douée en technique. Pourtant, À pied d’œuvre démontre le contraire. Le choix du 70mm (décidé en cours de tournage après la découverte de The Brutalist de Brady Corbet) s’avère particulièrement pertinent, notamment dans les gros plans, dans lesquels on arrive à avoir énormément de détails autour du personnage.
À l’inverse, les passages tournés en Super 8, utilisés pour traduire la subjectivité du personnage, créent un véritable vertige. Le spectateur se retrouve plongé dans l’esprit de Paul, désorienté, ballotté par ses pensées. Ce huitième long métrage marque sans doute un tournant dans la filmographie de Donzelli : parmi ses films plus ou moins aboutis, À pied d’œuvre apparaît clairement comme le plus maîtrisé sur le plan formel.
L’histoire d’un homme avant tout
Le film pourra susciter certaines réserves, notamment sur son point de vue, celui d’un « faux pauvre ». La précarité de Paul est en effet le prix d’une liberté choisie. Ancien photographe très bien rémunéré, il a délibérément quitté un métier lucratif, vidé de sens à ses yeux, pour se consacrer à l’écriture. Une situation qui diffère de celle de nombreux artistes, confrontés à la précarité sans jamais avoir eu le luxe du choix.
Mais À pied d’œuvre ne prétend pas dresser un tableau exhaustif de la pauvreté artistique. Le film s’organise avant tout autour de Paul Marquet, alter ego de l’écrivain et photographe Franck Courtès, dont Donzelli adapte ici le roman. Comme dans ses précédents films, la réalisatrice montre la précarité sans en faire un manifeste, préférant s’attacher à la trajectoire intime d’un homme prêt à tout sacrifier pour écrire, pour vivre sa passion, et non vivre de sa passion.
L’homme aux mille visages
Dans un film aussi étroitement centré sur un seul personnage, le choix de l’acteur est crucial. Et Donzelli ne se trompe pas. Bastien Bouillon, déjà remarquable dans La Nuit du 12, livre ici une nouvelle performance d’une grande justesse. Présent dans presque chaque plan, il parvient à incarner un personnage complexe, parfois froid, parfois vulnérable, toujours crédible.
Bouillon possède cette capacité rare à se fondre entièrement dans ses rôles, sans jamais donner l’impression de se répéter. Dans À pied d’œuvre, il pourrait presque porter le film à lui seul tant sa présence structure le récit. Son jeu précis et retenu permet au spectateur de s’attacher à Paul sans jamais le juger, même lorsque ses choix interrogent.
À pied d’œuvre est un film profondément touchant, formellement maîtrisé et porté par un acteur remarquable. En adaptant avec finesse le roman de Franck Courtès, Valérie Donzelli signe ici son premier grand film, celui où toutes ses intentions, narratives, esthétiques et émotionnelles semblent enfin converger. Un film qui parle de création, de solitude et de persévérance, et qui touche d’autant plus juste qu’il ne cherche jamais à forcer l’émotion.
Note : 8/10